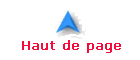Vive la Crise !
(Article publié dans le Monde daté du 14 octobre 2008, sous le titre :"Profitons de la crise pour refonder la société")
Comment ignorer l'accumulation oppressante des mauvaises nouvelles ? La bulle financière mondiale explose, le prix des matières premières s'envole, la pauvreté et la faim gagnent du terrain dans le monde. Sans compter la menace toujours possible d'une catastrophe naturelle, d'un accident nucléaire, d'une crise sanitaire ou d'un acte terroriste ! Tout cela au moment même où le monde prend conscience que la planète est dégradée, que les ressources sont limitées et que la survie des espèces vivantes n'est plus assurée. Y compris la nôtre. Cette concomitance inédite de difficultés, périls et contraintes s'annonce particulièrement difficile à enrayer par les acteurs de la planète (politiques, institutionnels, économiques, scientifiques, écologiques…). Elle constitue pourtant une chance historique de transformer le monde et de vivre mieux. La France pourrait, si elle le voulait, être à la pointe de ce combat.
Exceptions et illusions françaises
Si la " crise " est inquiétante, voire obsédante dans la plupart des pays développés (les enquêtes manquent sur les autres), elle l'est plus encore dans notre pays, où l'on mesure depuis des années un " moral " plus bas qu'ailleurs. L'inquiétude y est plus chevillée au corps, la méfiance plus forte, le cynisme plus apparent, la cohabitation plus difficile. De plus, les " vraies gens " savent désormais que la France est moins armée que les autres pour résister au marasme à venir, avec sa faible croissance et le montant de ses dettes. Et, bien sûr, ses " exceptions " nationales, dont certaines sont des handicaps à l'adaptation (sans même parler d'innovation) : irréalisme ; " uniformisme " ; amoralisme ; " petisme " ; culture de l'affrontement… Notre société " mécontemporaine " cultive le pessimisme et la peur. Elle s'inquiète (légitimement) de la hausse des prix, de la remontée du chômage, de l'accroissement de certaines inégalités, de la baisse (réelle, supposée ou à venir selon les cas) du pouvoir d'achat. L'économie souffre d'anémie et la société d'anomie (disparition des repères et valeurs collectifs permettant de guider les comportements individuels). Quant aux individus-citoyens-consommateurs-parents, beaucoup sont atteints de schizophrénie, de paranoïa ou d'hypocondrie.
Comment, dans ces conditions, aider les Français à garder (ou plutôt retrouver) le moral ? On peut faire trois suggestions. La première, en forme de clin d'œil, serait de s'éloigner davantage encore de la réalité. Outre le recours (déjà massif) aux antidépresseurs, on pourrait se conformer au précepte chinois des trois singes: ne rien voir (jeter les postes de télévision, ne plus lire les journaux) ; ne rien entendre (éteindre la radio, ne pas écouter les conversations) ; ne pas parler (sauf pour commenter les bonnes nouvelles, si l'on en trouve encore). Mais cette inconscience volontaire ne ramènerait pas l'insouciance. Mieux vaut pour la démocratie et pour l'avenir favoriser le débat entre Mutants et Mutins que de voir s'accroître le nombre des Moutons (ou autruches).
Lutter à la fois contre la misère et le misérabilisme
La seconde suggestion, plus sérieuse et a priori plus facile à mettre en œuvre, serait de relativiser la " misère nationale " ou celle dont on se sent personnellement victime par rapport à ce qui existe ailleurs. Ainsi, le revenu disponible moyen des ménages Français a atteint 33 000 euros en 2007 (tous revenus, charges et prestations sociales pris en compte), soit près de 3 000 euros par mois, à comparer à 250 en Pologne. Le coût horaire d'un ouvrier chinois est de 0,9 euro contre 13 en France. Notre taux d'épargne national est de 16%, ce qui laisse à la majorité des ménages une marge de manœuvre (il n'est que de 2% aux États-Unis). Pour tenter de rassurer les " classes moyennes " (concept pratique mais de moins en moins pertinent) sur leur sort relatif, on pourrait aussi évoquer l'accroissement spectaculaire des taux d'équipement des ménages pour les loisirs ou le confort de l'habitat, ou encore la montée en gamme continue et générale (mais méconnue) des achats d'alimentation ou de services.
Dans le même esprit politiquement incorrect, il serait bon de préciser également que la richesse individuelle s'est largement accrue au cours des dernières décennies : le pouvoir d'achat du revenu disponible par ménage a doublé en monnaie constante entre 1970 et 2007, alors que le temps de travail s'est beaucoup réduit. Ces rappels sont nécessaires pour lutter contre le paupérisme, le misérabilisme, le dolorisme et le victimisme ambiants, qui ne sont pas des facteurs de dynamisation mais d'insatisfaction et de tension. Cependant, ils ne sauraient en aucune façon empêcher de reconnaître et de déplorer la recrudescence récente des inégalités de revenus ou, surtout, des patrimoines. En effet, la croissance n'a pas profité uniformément à chacun et la solidarité nationale devra mieux faire son travail de redistribution, afin de compenser l'évolution de la distribution statistique cachée par l'usage des moyennes. Dans de nombreux domaines, la courbe de Gauss n'est en effet plus ce qu'elle était (notamment aux extrêmes) et il est important de s'y intéresser.
Pour y parvenir, la réduction sensible ou la suppression de certains écarts inacceptables est un préalable : stock options et parachutes dorés de certains dirigeants d'entreprises, niches fiscales pour contribuables fortunés, retraites " coup de chapeau " de hauts fonctionnaires, rentes de situation et autres privilèges " haut de gamme ". Un salarié, même correctement rémunéré, se sentira toujours frustré et en colère en sachant qu'un patron, un artiste ou un présentateur de télévision (étrangement moins, un sportif…) peut gagner des millions d'euros. Avant de demander aux " classes moyennes " de faire des efforts, il faudra demander (ou imposer) à la tranche supérieure des " nantis " une participation plus grande à la solidarité, un peu plus de décence et de vertu. Peu importe si l'impact macroéconomique est faible (ce n'est d'ailleurs pas toujours le cas) ; sa dimension symbolique est considérable, comme ses conséquences sur le climat intérieur. Dans la situation actuelle, l'exemplarité est la condition première de la paix sociale et de l'efficacité.
Réinventer la société de consommation
La troisième suggestion est plus essentielle. Le moment n'a jamais été plus opportun pour réinventer le modèle de " société de consommation " avec lequel nous vivons depuis une cinquantaine d'années et qui satisfait de moins en moins ceux qui en ont bénéficié sans en être toujours conscients. On constate en effet que la corrélation est assez faible entre le niveau des revenus, des dépenses et du contentement. Le lien automatique entre consommation, plaisir et " progrès " n'est plus un postulat partagé. Dans les enquêtes qualitatives, l'achat d'un nouveau bien d'équipement (téléviseur à écran plat, téléphone mobile, voiture…) n'apparaît pas comme un gage de bonheur supplémentaire. La consommation s'apparente à une recherche, souvent infructueuse, de consolation, un moyen de remplir un vide existentiel croissant. Avec, à la clé, beaucoup de frustration : " à quoi ça sert, tout ça ? ". Et aussi un peu de culpabilisation, aggravée par la prise de conscience écologique : " consommer, c'est détruire… ". A quoi s'ajoute le sentiment désagréable d'être manipulé par un " système marchand " plus " exhausteur " qu'exauceur de désir.La sagesse voudrait ainsi que la régulation collective des marchés aujourd'hui souhaitée s'accompagne d'une régulation individuelle des désirs. Réfléchie, décidée et assumée. Elle est déjà apparente dans certaines tentatives de réponse à la crise ou de résistance au système de la consommation mises en place par des individus, des familles ou des communautés. Les adeptes du low cost ou du hard discount sont ainsi de plus en plus nombreux ; ils ne se recrutent pas seulement parmi les ménages aux fins de mois difficiles. Ceux qui s'inquiètent pour leur santé, celle de leurs enfants ou de la planète recherchent les aliments " bio ". Le souci de solidarité avec les pays pauvres incite à l'achat de produits issus du commerce " équitable " ou " solidaire " labellisé. Mais il peut à l'inverse favoriser la sélection de producteurs nationaux ou locaux. Certains ménages réduisent leurs rejets de CO2 en utilisant moins leur voiture. Des touristes compensent financièrement les nuisances qu'ils occasionnent en prenant l'avion ou en fréquentant des sites fragiles. Des consommateurs se font les apôtres de la " frugalité " en réduisent leurs volumes d'achats et leurs dépenses. D'autres diminuent leur consommation d'eau ou d'électricité en supprimant les bains, en installant des capteurs solaires ou des pompes à chaleur. La tendance " éco " s'annonce durable, comme le développement auquel elle veut s'associer. Elle signifie à la fois économie et écologie. L'avenir est à l'écolonomie. A moins que ce ne soit à l'éconologie.
Participation et responsabilisation
Le défi pour les années à venir n'est pas tant de réformer l'offre, sous-entendu de réguler le capitalisme ou le libéralisme planétaire, que d'accompagner la transformation de la demande, qui a déjà commencé. Ceux qui imaginent que la crise actuelle est passagère s'illusionnent ; les contraintes financières et environnementales ne permettront plus de tirer des traites sur les générations futures. Mais ceux qui en déduisent que c'est le début d'une catastrophe pour les sociétés développées se trompent aussi. C'est au contraire l'occasion pour elles de revenir à des " fondamentaux " : un système de valeurs moins uniquement fondé sur le désir mimétique ; des vies individuelles plus riches parce que plus autonomes et responsables ; une planète plus saine et durable ; des relations sociales plus détendues. Ainsi, la nouvelle société de consommation ne serait plus comme aujourd'hui fondée sur des motivations " défensives ", liées au besoin de réparer les dégâts occasionnés par le fonctionnement de la société : stress ; mal-être ; fatigue ; besoin de se " divertir " "… A quoi s'ajoutent les pressions diverses pour " être à la mode " et disposer des attributs toujours renouvelés (notamment technologiques) de la modernité.
Durckheim évoquait l'utilité, voire la nécessité d'un " guidage social " des individus, à travers notamment un système de valeurs partagé. C'est parce qu'il est aujourd'hui absent (l'anomie actuelle détruit le " modèle républicain " et favorise le communautarisme) que beaucoup de citoyens-consommateurs se sentent mal dans leur peau et dans leur époque. C'est en leur redonnant un nouveau cadre de référence commun (sans attenter bien sûr aux libertés individuelles) que l'on pourra réduire l'insatisfaction dans le présent et restaurer le goût de l'avenir. Cela implique, entre autres choses, de rendre moins omniprésente la comparaison et la compétition avec les autres, de rendre plus immatériels et personnels (mais en même temps partagés) les objets du désir. Dans ce contexte, la consommation sera davantage un miroir reflétant l'identité réelle du consommateur qu'une vitrine exposant son statut social ou ses différents rôles et " avatars ".
Une occasion historique
Il est donc urgent, et la conjoncture s'y prête plus que jamais, de dessiner un nouveau modèle de société, dans lequel la consommation ne servira plus seulement à satisfaire les sens, mais aussi à donner un sens à la vie et de la longévité à la planète. Pour un certain nombre d'" alterconsommateurs ", certes un peu " intégristes ", le plaisir vient de l'abstinence et non plus de l'abondance. Pour les autres, il pourrait passer par la recherche d'harmonie. L'esprit et le mental sont de moins en moins séparés du corps, dans une vision holistique qui va se développer. Pour mesurer ces motivations et la capacité de la société à les satisfaire, il faudra se doter de nouveaux indicateurs de " bien-être " qui viendront compléter et peut-être un jour remplacer ceux, dépassés et finalement autodestructeurs, de la richesse matérielle. Il faut souligner que cela ne signifie pas que le seul horizon possible soit la " déconsommation ", facteur d'une décroissance qui aurait des conséquences douloureuses, voire désastreuses, pour de nombreux individus.
En quatre décennies, la France a connu comme l'ensemble des pays développés quatre " métatendances " qui ont largement déterminé son évolution : individualisation ; globalisation ; féminisation ; dématérialisation. Chacune d'elles à été initiée et accélérée par l'innovation scientifique et technologique (pilule contraceptive, moyens de transport, outils de communication…). Une autre tendance lourde est apparue plus récemment : la volonté de participation des citoyens et des consommateurs à leur destin collectif et personnel. Favorisée elle aussi par la technologie (et notamment la révolution internet 2.0), elle peut permettre de transformer le monde. A condition que cette participation s'accompagne de responsabilisation. C'est-à-dire que le mimétisme ne soit plus le principal déterminant des comportements et des projets de vie.
Dans le contexte actuel de catastrophes avérées, attendues ou redoutées, une réflexion collective est donc possible et souhaitable. D'autant qu'il s'agit moins d'un luxe de nantis que d'un réflexe de survie. Il est important de favoriser et de nourrir le débat, les propositions concrètes et le consensus que cela nécessite. A ces conditions, auxquelles devront s'ajouter l'exemplarité, la créativité, la pédagogie et le courage, elle peut déboucher sur une " utopie " fondatrice d'une nouvelle civilisation, de modes de vie plus satisfaisants et durables. Alors, vive la crise !
Gérard Mermet